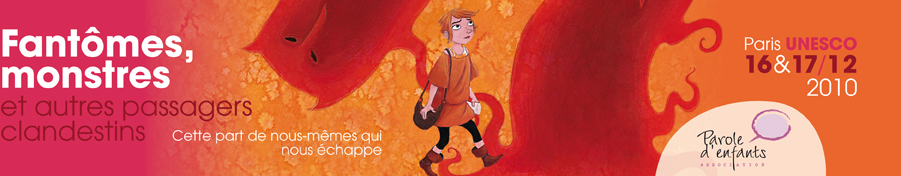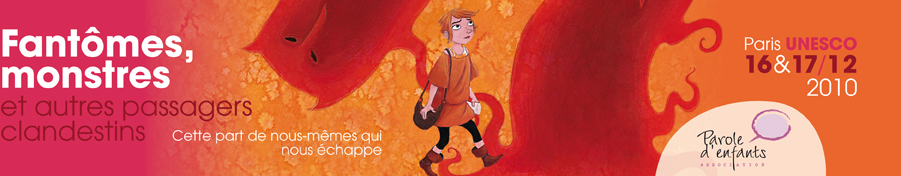jeudi 16 décembre
9h30
Ouverture
Claude Seron
Directeur de Parole d' Enfants
10h00
Conférences au choix
Jean-Paul MUGNIER
Esprit es-tu là ?
Au « Je est un autre » pour l’autre d’Arthur Rimbaud, nous pourrions répondre, en lien avec le thème de ce colloque par un « Je suis multiple ». En effet chacun de nous est habité par de nombreux autres qui nous construisent et font de nous ce que nous sommes :
• nos parents et les héritages familiaux qu’ils nous lèguent,
• l’enfant qui est en nous et dont la vulnérabilité, la souffrance, se réveille à certains moments difficiles de notre existence,
• des personnes significatives qui ont contribué à consolider l’estime que nous avons de nous-mêmes, ou au contraire l’ont endommagée, etc.
Tous ces autres sont régulièrement présents lorsque nous rencontrons les familles. S’invitant à notre insu, ils participent à la construction d’une réalité commune, influencent les choix de chacun, ceux des membres de la famille comme ceux des thérapeutes, alors que bien souvent nous avons l’illusion d’avoir choisi librement, en toute connaissance de cause !
Comment rendre présents ces esprits lors de nos rencontres avec la famille ? Comment les libérer de leur souffrance pour qu’à leur tour ils nous libèrent ? C’est autour de ces interrogations que nous proposons de réfléchir lors de notre intervention.
Jean-Paul MUGNIER est éducateur spécialisé, thérapeute familial, directeur de l’Institut d’études Systémiques, auteur de différents ouvrages dont « Les stratégies de l’indifférence » (Paris, Éditions Fabert, 2002), « La promesse des enfants meurtris » (Paris, Éditions Fabert, 2005), « Le silence des enfants » (Paris, Éditions L’Harmattan, 1999).
Philippe DENIS
Mourir plutôt que révéler son statut ? Le travail de mémoire comme réponse au déni et à la stigmatisation du sida en Afrique du Sud
Si le sida, une maladie qui touche plus de cinq millions de personnes en Afrique du Sud, était une maladie qui pouvait dire son nom, elle n’aurait pas fait autant de victimes. Beaucoup portent le virus en eux sans le savoir ou plutôt sans vouloir le savoir tant ils ont peur du regard d’autrui sur leur corps malade. Ceux qui se savent séropositifs cachent leur statut à leurs amis et aux membres de leur famille des semaines, des mois et quelquefois des années. Certains malades refusent de commencer un traitement antirétroviral de peur d’être reconnus à la clinique par des voisins ou d’être identifiés par des membres de la famille quand ils commenceront à prendre les médicaments. Le déni et la stigmatisation freinent ou empêchent la prévention, le traitement et les soins aux personnes vivant avec le sida.
Pourquoi en est-il ainsi ? Quels mécanismes psychosociaux poussent les porteurs du virus à mentir à leurs proches et à eux-mêmes et à refuser un traitement qui pourrait leur sauver la vie? Quel démon habite cette maladie que l’on ne peut pas nommer ? Ce n’est pas par hasard que la cause la plus fréquemment évoquée pour éviter de regarder la vérité en face est la sorcellerie. Dans les sociétés africaines, la maladie n’est pas causée par quelque chose, un virus par exemple, mais par quelqu’un. Mais qui a intérêt à faire mourir autant de gens ?
L’exposé comprendra deux parties. La première examinera, sur la base d’une douzaine de récits de vie de personnes séropositives, le phénomène du déni, du silence et de la stigmatisation qui accompagne l’épidémie du sida dans l’Afrique du Sud contemporaine. La seconde décrira l’expérience du Centre Sinomlando auprès d’enfants affectés ou infectés par le sida et leurs familles dans la province du KwaZulu-Natal et ailleurs en Afrique du Sud.
Philippe Denis est professeur à l'université du KwaZulu-Natal et professeur invité d’histoire de l’Afrique subsaharienne au département d’histoire de l’Université catholique de Louvain. Il est directeur du Sinomlando Centre for Oral History and Memory Work in Africa (Afrique du Sud), un institut de recherche et de travail communautaire à l’université du KwaZulu-Natal où il mène auprès de familles touchées par le sida un « travail de mémoire » visant à ouvrir un espace de communication sur la sexualité, la maladie, la mort et tous les autres secrets de famille.
11h30
Hélène ROMANO
Petits cœurs brisés de chagrins incompris : quand la mort touche l’enfant, comment rattraper la vie ?
Un titre suffisamment large, pour à la fois envisager la mort de l’enfant et ses répercussions (sur les parents mais surtout sur la fratrie) et la mort à hauteur d’enfant (côté enfant endeuillé), qu’il s'agisse de fratrie (née ou à naître) de parents ou d’amis : les mots pour la dire, les mots pour accompagner le chagrin, les visages du chagrin.
Hélène Romano est docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne, psychothérapeute à la consultation spécialisée de psychotraumatisme du CH Henri Mondor, Créteil (94). Elle est l’auteur de « Dis, c'est comment quand on est mort ? Accompagner l'enfant sur le chemin du chagrin » (Éd. La pensée sauvage, 2009) et « Enfants maltraités : descriptions cliniques, évaluation et prise en charge » (Éd. Fabert, 2009).
12h45 Déjeuner (libre)
14h15
Conférences au choix
Serge TISSERON
L’écho des fantômes :
comment s’en libérer ?
Lorsqu’une personne a vécu un événement traumatique qu’elle n’a pas pu symboliser complètement, sa manière de se comporter va toujours en être affectée.
Elle est divisée en deux, entre une partie de lui qui voudrait parler pour se soulager, et une autre qui craint de le faire, ou se l’interdit.
C'est pourquoi Serge Tisseron a proposé d’écrire le Secret ainsi envisagé comme un fait psychique avec un « S » majuscule afin de le distinguer de tous les secrets relationnels écrits avec « s » minuscule, qui n’ont évidemment pas les mêmes conséquences.
Le Secret provoque des perturbations de la communication de celui qui en est affecté. C’est ce qu'il a appelé les suintements du secret. Ces perturbations, et les efforts faits par l’entourage pour s’en accommoder, déterminent des conduites perturbées à la génération suivante. C’est ce qu'il a appelé les ricochets du secret. Certains sont liés aux effets directs des comportements des adultes sur l’enfant, d’autres aux histoires que celui-ci se raconte pour tenter de comprendre ce qu’on lui cache.
Cette façon de comprendre les secrets est également utile pour prévenir leurs effets pathogènes en institution. Dans tous les cas, il est essentiel de permettre à chacun d’avoir accès à la vérité qui le concerne. Cela ne le libère pas de ses chaînes, surtout si la construction de sa personnalité a été marquée par un secret, mais lui permet de commencer à se construire enfin sur des bases solides. Tout n’est pas résolu pour autant, mais c’est déjà considérable !
Serge Tisseron est psychiatre et psychanalyste. L’essentiel de son travail porte sur trois thèmes : les relations que nous établissons avec les images, nos rapports aux nouvelles technologies et bien sûr les secrets de famille. Il a publié une trentaine d’ouvrages dont le célèbre « Secrets de famille, Mode d’emploi »
(Éd. Ramsay, 1996). Il est également auteur de bandes dessinées.
Fabienne COLLARD
et Claire VAN CRAESBEECK
Quand le fantôme se prénomme
« maladie mentale » au sein d’une famille…
La maladie mentale frappe généralement sans prévenir. L’entourage est alors subitement confronté à des symptômes de troubles inquiétants dont il ignorait jusque là l’existence. Voir ces symptômes se développer chez un être que l’on aime avec comme circonstance aggravante le fait de ne pas arriver à le soigner et d’être rejeté par lui, suscite un sentiment de culpabilité et une douleur morale tels que, très souvent, la situation perdurant, le climat au sein de la famille se dégrade, tout comme la santé de ses membres.
C'est pourquoi il importe de soutenir les familles dans leur processus d’apprivoisement, d’acceptation et de cohabitation avec « leur fantôme ».
Par son vécu avec la personne malade, par la connaissance intime de son proche et des manifestations de sa maladie, la famille devient dès lors un partenaire incontournable auprès des professionnels dans la prise en charge du patient.
Fabienne Collard est assistante sociale et coordinatrice de l'ASBL Similes Wallonie. Claire Van Craesbeeck est psychologue, chargée de projet.
L’association Similes Wallonie offre aux proches de personnes atteintes d’un trouble psychique un espace où le partage d’expériences, la solidarité et le soutien entre pairs, permet de mettre fin au silence, à l’ignorance, la solitude et le sentiment d’impuissance…
15h30
Dominique GROS
Le monstre cancer et ses représentations
Comment atténuer la violence du symbolique ?
Son ancienneté, ses réalités douloureuses et sa fréquence, font du cancer une figure du mal. équivalent fantasmatique du Minotaure, il est ce monstre qui réclame chaque année son lot de victimes innocentes.
à côté de ses réalités biologiques et médicales, le cancer est l’objet de représentations multiples. Que l’on soit malade du cancer ou non, chacun d’entre nous possède un rapport singulier à cette maladie. Les représentations que j’ai du mal cancéreux disent des choses de moi. Mon imaginaire du cancer me révèle, il raconte mon histoire, ma psychologie, mon rapport au corps, ma culture… ma conception de la vie. Il dit mon désir de vérité et d’illusions. De même, l’imaginaire collectif et social du cancer informe sur la société.
Soigner et aider un malade requiert de prendre en compte autant l’objet maladie que le sujet malade. Sans oublier que - soignant ou aidant - nul n’échappe à ses propres représentations de la maladie quand il soigne ou aide un malade du cancer.
Dominique Gros est médecin, praticien hospitalier aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Un recueil de ses articles a été publié chez Springer « Cancer du sein : entre raison et sentiments » : un livre d’une construction originale, qui mêle l’expression franche de l’auteur à de splendides illustrations d’œuvres d’art.
17h00
Maryse VAILLANT
L'ombre restante, se ré-apprivoiser le pire pour affronter la suite
Nul ne choisit ses parents, son pays ou son enfance. Personne n'est le maître de son passé ni des mécanismes de défenses qu'il a mis en place pour affronter les épreuves de son existence. Avoir des parents fragiles, tomber malade, rencontrer la mort, tant d’événements imprévisibles et inévitables qui mettent en péril la vie ou l'équilibre. Or, on survit. Même au pire. Bancal, ébranlé, douloureux, fautif, anxieux. On a refoulé, oublié, on a développé des stratégies, on s'est construit un rempart d'habitudes. Dans le meilleur des cas, on a donné, réparé, pardonné. On s'est efforcé de se protéger et de protéger les siens.
Un jour, au détour d'une maladie, d'une crise, d'un deuil, on sent qu'une ombre est restée accrochée à nos pas. Comme la trace d'un souvenir effacé, l'écho d'une vieille chanson triste, la diffuse menace d'un recommencement. Vient alors le moment d'apprivoiser ce qu'on a cru réglé, de se familiariser avec l'ombre restante pour se l'approprier. Faire du pire son allié.
Maryse Vaillant est psychologue et écrivain. Elle a écrit de nombreux livres parmi lesquels « Pardonner à ses parents » (Pocket, 2004), « Il m'a tuée. Au cœur des secrets de famille » (Pocket, 2005), « Une année singulière, avec mon cancer du sein » (Albin Michel, 2008). Son dernier ouvrage « Au bonheur des grands-mères » vient de paraître aux éditions érès.
|
|
|
|
vendredi 17 décembre
9h00
Boris CYRULNIK
Le murmure des fantômes
Pour ceux qui reviennent de l’enfer, qui ont côtoyé la mort « en personne », qui ont été initiés par l’expérience traumatique, comment dire qu’on est un revenant ? Comment faire comprendre que la souffrance n’est pas la dépression et que, souvent, c’est le retour à la vie qui fait mal ?
Pourtant, même quand les revenants envahissent la vie, quand « l’empreinte de la maison des morts » marque la mémoire de sa trace indélébile, sous certaines conditions, il est possible d’apprivoiser ses fantômes, de revisiter ses dialogues intérieurs, de raccommoder sa personnalité déchirée et de reprendre place dans l’aventure humaine.
Boris Cyrulnik est neurologue, psychiatre, éthologue et psychanalyste. Responsable d'un groupe de recherche en éthologie clinique à l'hôpital de Toulon et enseignant l'éthologie humaine à l'Université du Sud-Toulon-Var, il est surtout connu pour avoir développé le concept de « résilience » (renaître de sa souffrance). Il est l’auteur de nombreux livres parmi lesquels « Je me souviens… » (2010), « Autobiographie d’un épouvantail » (2008), « Le Murmure des fantômes » (2003), « Un merveilleux malheur » (1999) aux Éditions Odile Jacob.
10h15
Conférences au choix
Édith GOLDBETER-MERINFELD
Fantôme, tiers pesant et tuteur
de résilience
L’exposé présente une manière d’aborder le processus thérapeutique à la lumière des concepts de tiers pesant, fantôme, résilience et deuil.
Si l’on considère le psychothérapeute comme un tuteur de résilience professionnel dont l’objectif est de réveiller les ressources de ses patients pour dépasser ce qui les traumatise, on peut avancer l’hypothèse que sa manière d’interagir et le positionnement qu’il adopte, au-delà du contenu de ses échanges avec le(s) patient(s), jouent un rôle primordial dans l’évolution de la thérapie.
Il y a alors lieu de se demander si la place qu’il occupe et/ou se voit offrir dans le système thérapeutique, est choisie par lui en référence à son modèle d’intervention, est créée de toutes pièces sans lien avec l’histoire de la famille (ni avec la sienne) ou si elle a déjà été « habitée »
précédemment. Dans ce dernier cas, on pourrait s’interroger sur l’identité du précédent occupant, la fonction éventuelle de ce fantôme, et investiguer si l’attente qu’une personne inconnue jusque-là – le tuteur de résilience/thérapeute/tiers pesant – prenne son siège et donc en occulte sa vacuité, ne signale pas l’impossibilité pour la famille de faire le deuil d’un tiers pesant disparu… L'oratrice précisera, pour commencer, les notions de tiers pesant, de fantôme et de deuil impossible dans le contexte de la thérapie familiale, pour ensuite les mettre en rapport avec la fonction de tuteur de résilience.
Édith Goldbeter-Merinfeld est directrice de la formation à l’Institut d’études de la Famille et des Systèmes Humains (Bruxelles), auteur du « Deuil impossible. Familles et tiers pesants » (De Boeck). Maître de Conférence à l’ULB, enseignante à l’Université de Paris VIII et à l’Université du Sud-Toulon-Var elle est rédactrice en chef des Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux et directrice de la collection « Carrefour des Psychothérapies » (De Boeck).
Valérie ROSOUX
Fantômes et relations internationales
Quelle transmission au lendemain d’un conflit international ou intercommunautaire ? La question s’avère cruciale aux quatre coins du monde. Malgré les discours appelant à la réconciliation au Proche-Orient, en Afrique des Grands Lacs, dans les Balkans, en Irak ou en Afghanistan, les témoignages concordent pour dépeindre une atmosphère de méfiance et de discrimination. Pourtant, dans nombre de cas, les familles endeuillées devront un jour ou l’autre à nouveau vivre ensemble. L'impératif de coexistence force à s'interroger : comment gérer les conséquences de ce qui est advenu ? Que transmettre après l’horreur ? Est-il possible ou illusoire de « démobiliser les esprits » ?
La figure du fantôme permet d’éclairer la portée, mais aussi les limites, de toute tentative de résolution des conflits dans des régions hantées par la guerre, ses visages torturés et ses corps sans sépulture. Quelles sont les traces d’un passé tragique non digéré ? à quels processus cognitifs et symboliques sont-elles liées ?
Ces interrogations invitent à prendre en considération les phénomènes de transmission d’un point de vue non seulement individuel mais aussi collectif. Comment les représentants d’un groupe (communauté, état, ethnie,…) transmettent-ils un passé douloureux ? Avec quelles conséquences sur les individus ?
Le cœur de cette réflexion concerne l’interaction entre mémoire vive et mémoire officielle. Comment articuler d’une part l’ensemble des souvenirs partagés par les individus, qu’ils aient été vécus ou transmis, et d’autre part les mises en récit publiques du passé ?
Une transmission sur le plan officiel peut-elle, oui ou non, favoriser la ré-humanisation de l’autre ?
Valérie Rosoux est chercheuse qualifiée du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS). Licenciée en philosophie et docteur en sciences politiques, elle enseigne la négociation internationale à l’UCL. Elle est membre du Centre d’études des crises et des conflits internationaux (CECRI).
11h45
Jean EPSTEIN
Avec quels démons les adolescents doivent-ils se (dé)battre ?
Voici les questions qui seront abordées à l’occasion de cette conférence :
• La crise d'adolescence amène le jeune à se demander quel autre genre de lui-même il va devenir.
• Quelle est la partie en moi qui va s'imposer, est-ce celle qui me fait le plus peur ?
• Vais-je finir par ressembler aux côtés les plus insupportables de mon père, de ma grand-mère ?
• Comment trouver des aménagements pour cohabiter avec la partie que j'aime le moins en moi ?
• Avec quels héritages qui se sont glissés dans mon sac à dos à mon insu vais-je devoir composer ?
• à quelle famille problématique, avec ses ombres et fantômes dans les placards, n'ai-je pas le choix d'appartenir ?
Jean Epstein est psychosociologue. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont, avec Cécile Desmazières-Berlie, « Nous sommes des parents formidables : 100 Clefs pour réussir l'éducation de nos enfants » (Flammarion, 2009), et avec Henri Joyeux et Philippe Vaur, « Le suicide, qui n'y a jamais pensé ? Des clefs pour comprendre, parler, prévenir » (éd. François-Xavier de Guibert, 2008).
12h45 Déjeuner (libre)
14h15
Conférences au choix
Francine ROSENBAUM
Thérapie à Babel : souffrances et avatars des langues maternelles clandestines
à partir de son expérience clinique avec les enfants et les familles multiculturelles, Francine Rosenbaum mettra en évidence certaines constantes et certains outils méthodologiques qui définissent le cadre thérapeutique de la clinique interculturelle et qui modifient l’évaluation traditionnelle des troubles langagiers et comportementaux des enfants de migrants. Elle espère ainsi contribuer à mettre en lumière les aspects éthiques, relationnels, affectifs et cognitifs du développement des compétences langagières liés à la reconnaissance ou au déni de la langue maternelle dans les situations de migration ainsi que les aspects paradoxalement pathogènes d’un cadre thérapeutique monolingue. Elle propose un regard sur la communication dans les étapes clé du cycle de vie ainsi qu’une réflexion sur les moyens qui favorisent une alliance thérapeutique significative capable de résorber les troubles langagiers et comportementaux dus aux images ou représentations marginalisantes attribuées à une appartenance linguistique.
Francine Rosenbaum est orthophoniste ethnoclinicienne, elle s’est spécialisée dans les troubles de la communication et du langage attribués à la migration et au multilinguisme. Dès les débuts de son activité clinique elle a constaté que le mal être des migrants se cristallise souvent dans des symptômes qui lèsent la parole ou l’écriture. Les enfants qui en souffrent aboutissent, avec leurs parents, dans les CPM. Dans le contexte de la migration, les références épistémologiques monoculturelles et les outils d’évaluation monolingues se sont révélés insuffisants et insatisfaisants aussi bien pour les évaluations que pour la prise en charge d’une problématique complexe qui dépasse largement les modèles psychopédagogiques et rééducatifs traditionnels. Elle s’est alors formée en thérapie familiale contextuelle, en hypnose ericksonienne et en ethnopsychiatrie. Outre son activité clinique, elle effectue des supervisions, des recherches et des formations à la prise en charge des familles migrantes et à la médiation linguistico-culturelle dans le domaine psychopédagogique et thérapeutique en Suisse et en Italie. Auteur de nombreux articles, elle a publié en 1997
« Approche transculturelle des troubles de la communication – Langage et migration » aux éditions Masson, et en 2010 « Les humiliations de l’exil. Les pathologies de la honte chez les enfants de migrants » aux éditions Fabert.
Philippe LACROIX
« Qui vole un œuf … »
Fantômes, monstres et autres passagers clandestins nous échappent-ils toujours ? Ou est-ce leur rencontre qui fait que nous sommes en constante évolution ?
Le parcours de vie de Philippe Lacroix témoigne que les mêmes fantômes sont tantôt démons et tantôt anges gardiens. L’énigme reste néanmoins entière de savoir comment passer de l’un à l’autre.
Dans son exposé il tentera de montrer au travers de quoi la rencontre avec ces fantômes est possible, voire inévitable. En quoi cela bouleverse nos perspectives et permet de se construire.
Nous ne sommes jamais inscrits dans un destin figé; nos valeurs, notre relation au monde, nos modes de fonctionnement s’articulent parfois de façons bien différentes et génèrent d’autres histoires dans notre propre histoire.
Philippe Lacroix est agrégé de l’enseignement secondaire supérieur et professeur d’anglais et de néerlandais dans l’enseignement de promotion sociale pour adultes.
Son parcours est atypique. à 14 ans, alors que le noyau familial vit de nombreuses turbulences, il décroche du monde scolaire. Vers 17 ans il entame ce que l’on peut appeler une « carrière » de délinquant qui aboutit à sa condamnation à mort le 20 janvier 1994, à l’âge de 34 ans.
C’est en prison qu’il met en place sa re-construction au travers des études. Il sortira au bout de presque 15 ans et obtiendra son diplôme lors de ses deux premières années de liberté.
16h00
Christophe ANDRÉ
« Vivons heureux en attendant la mort »
Le bonheur et les fantômes du malheur
Nous rêvons toutes et tous d’une vie heureuse. Mais le déroulement de nos existences en décide souvent autrement.
Il nous faut affronter l’adversité du quotidien sans nous y noyer. Tenir à distance les fantômes du passé et leurs malédictions (« Dans la famille, on n’est pas faits pour le bonheur », « Tu es heureux(se) ? Tu es en faute ! », « Le bonheur ? Impossible, avec ton passé… »). Et puis vivre avec l’idée de la mort, pour nous et ceux que nous aimons.
La conférence abordera la question des rapports étroits entre bonheur et malheur, leur coexistence discrète au quotidien, et les conditions d’émergence du bonheur dans le malheur (avant, pendant, après).
Christophe André est psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, au sein d’une unité de psychothérapie comportementale et cognitive. Il est spécialisé dans la prise en charge et la prévention des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs. En France, Christophe André a été l’un des premiers à introduire l’usage de la méditation en psychothérapie. Il est notamment l’auteur de « Imparfaits, libres et heureux. Pratiques de l’estime de soi »,
« Les états d’âme. Un apprentissage de la sérénité » aux Éditions Odile Jacob. Il alimente également un blog http://psychoactif.blogspot.com/ dans lequel il livre avec simplicité ses petites recettes du bonheur au quotidien.
|